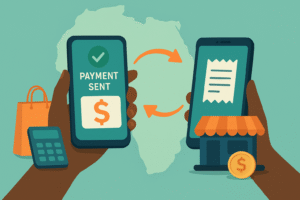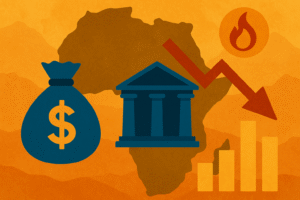C’est une scène banale et pourtant hautement symbolique : dans une petite agence de transfert d’argent à Paris, un père de famille sénégalais patiente devant le guichet. À la fin du mois, une partie de son salaire repart vers Dakar. Là-bas, sa mère paiera les frais de scolarité de ses petits-enfants et son frère pourra poursuivre la construction de sa maison. Cette scène, reproduite des millions de fois à travers le monde, illustre la force invisible mais décisive qui relie la diaspora africaine à son continent : les paiements.
Selon la Banque mondiale, les envois de fonds de la diaspora africaine ont dépassé les 100 milliards de dollars en 2023. Un chiffre colossal, supérieur à l’aide publique au développement reçue par l’ensemble des pays africains. Derrière ces flux, il n’y a pas seulement des chiffres, mais des histoires, des sacrifices et une économie parallèle qui irrigue tout un continent.
La diaspora, un acteur économique sous-estimé
On évoque souvent la diaspora africaine comme une force culturelle ou politique. Mais elle est avant tout un acteur économique de premier plan. Près de 170 millions d’Africains vivent aujourd’hui hors du continent, selon l’Union africaine. Et leurs contributions financières ne cessent de croître.
Ces transferts ne se limitent pas aux dépenses du quotidien. Ils financent l’éducation, la santé, les logements, l’entrepreneuriat. Ils alimentent aussi des investissements immobiliers, des PME locales, des abonnements numériques ou des projets collectifs comme des écoles ou des centres de santé. Autrement dit, la diaspora agit comme un pont financier et économique entre deux mondes.
Une « monnaie affective »
Mais réduire ces paiements à de simples flux monétaires serait ignorer leur véritable nature. Derrière chaque envoi se cache une histoire familiale, un attachement viscéral à la terre natale.
Un chauffeur de bus à Bruxelles qui envoie 200 euros par mois à Ouagadougou n’aide pas seulement ses proches : il perpétue un lien, il entretient un fil invisible qui relie son quotidien européen aux réalités burkinabè. Une étudiante ghanéenne à New York qui paie les études de son frère à Accra ne fait pas qu’assumer une charge : elle investit dans l’avenir de sa famille et, par ricochet, de son pays.
Ces paiements incarnent ce qu’on pourrait appeler une monnaie affective : une valeur où s’entrelacent solidarité, identité et espoir.
Les obstacles persistants
Pourtant, envoyer de l’argent en Afrique reste un parcours semé d’embûches.
- Des frais exorbitants. L’Afrique subsaharienne détient le triste record des transferts les plus chers au monde, avec des commissions oscillant entre 7 et 10 %. Loin de l’objectif fixé par l’ONU (3 % maximum).
- Une accessibilité limitée. Dans de nombreuses zones rurales, recevoir un transfert implique parfois des heures de trajet, faute d’infrastructures financières suffisantes.
- Des délais trop longs. Malgré la numérisation, certains transferts prennent encore plusieurs jours, surtout lorsqu’ils passent par des banques traditionnelles.
- Le recours à l’informel. Beaucoup de migrants continuent d’utiliser des circuits parallèles, plus rapides mais risqués, avec leur lot de fraudes et de pertes.
Ces défis freinent l’impact réel des paiements et creusent les inégalités.
Le tournant numérique
Face à ces blocages, l’Afrique a trouvé dans la technologie un accélérateur inédit. L’essor du mobile money – de M-Pesa au Kenya à Orange Money en Afrique de l’Ouest – a bouleversé les pratiques. Désormais, un simple téléphone portable suffit pour recevoir de l’argent, régler une facture, épargner ou accéder à un microcrédit.
Pour la diaspora, ces innovations changent tout :
- les envois sont instantanés,
- les coûts diminuent,
- la traçabilité s’améliore,
- et les bénéficiaires accèdent à des services financiers jusque-là hors de portée.
À cela s’ajoute l’émergence des fintechs, africaines ou internationales, qui testent de nouvelles solutions : portefeuilles numériques interconnectés, cartes virtuelles, blockchain. Autant d’outils qui redéfinissent la manière dont circule l’argent entre la diaspora et l’Afrique.
Des transferts qui deviennent investissements
L’un des défis actuels est de transformer cette manne financière en levier de développement durable. Plusieurs initiatives vont dans ce sens.
Certains pays émettent des obligations de la diaspora, des titres d’État destinés à financer des projets d’infrastructure grâce aux épargnes des expatriés. Des plateformes permettent de convertir les envois en produits d’épargne ou en micro-assurance. Des fonds collectifs réunissent les contributions de migrants pour financer des projets communautaires.
Ainsi, l’argent envoyé ne se limite plus au soutien familial. Il peut aussi devenir un outil de construction collective.
Diaspora et commerce : une nouvelle frontière
Au-delà des transferts familiaux, la diaspora joue aussi un rôle croissant dans le commerce. Mode, gastronomie, musique, artisanat : les entrepreneurs africains de l’étranger exportent leur culture via le e-commerce et s’appuient sur les paiements numériques pour gérer leurs transactions.
La mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ouvre également de nouvelles perspectives. Simplifier les paiements transfrontaliers en Afrique pourrait permettre à la diaspora de devenir un acteur central de ce marché continental en devenir, connectant l’Afrique à l’Europe, l’Amérique ou l’Asie.
Une nouvelle culture des paiements
Les jeunes générations, plus technophiles, réinventent le rapport aux paiements. Pour elles, envoyer de l’argent ne signifie pas seulement aider sa famille, mais aussi bâtir un patrimoine. Investir dans une startup locale, acheter un terrain, financer une coopérative agricole : autant de gestes qui traduisent une conscience nouvelle du rôle économique de la diaspora.
Cette mutation culturelle transforme la diaspora en acteur stratégique du développement, conscient de son pouvoir collectif.
Plus qu’un transfert, une force transformatrice
Au bout du compte, la relation entre la diaspora africaine et les paiements dépasse largement la dimension financière. Elle incarne une histoire faite de mobilité, de résilience et d’innovation. Chaque virement, chaque dépôt, chaque transfert devient un acte politique et économique.
Avec la révolution numérique, ces paiements peuvent se faire plus rapides, moins chers et plus inclusifs. Mais le défi reste immense : réduire les coûts, renforcer la régulation, développer l’inclusion financière et surtout canaliser une partie de ces flux vers des investissements structurants.
La diaspora africaine n’est pas seulement un pont entre les continents. Elle est, par ses paiements, une véritable colonne vertébrale économique capable de soutenir la transformation du continent au XXIᵉ siècle.