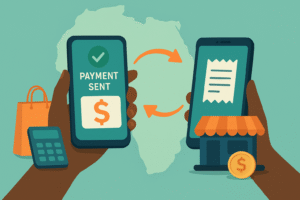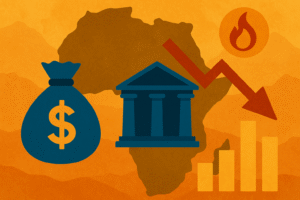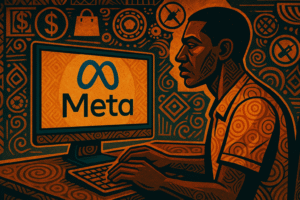Une alerte sur les grandes économies du continent
En septembre 2025, l’agence de notation Moody’s a publié une analyse qui sonne comme un avertissement pour plusieurs grandes économies africaines. Le Nigeria, le Kenya, l’Angola, le Ghana et l’Afrique du Sud figurent parmi les pays où le coût du financement reste extrêmement élevé, malgré des efforts de consolidation budgétaire et une amélioration relative des recettes fiscales. Selon l’agence, les écarts de taux auxquels ces pays doivent emprunter sur les marchés internationaux dépassent souvent les 500 points de base, un niveau qui limite drastiquement leur capacité à se financer à long terme.
Cette situation reflète une double réalité. D’un côté, les États africains doivent mobiliser des capitaux considérables pour financer leurs infrastructures, leurs programmes sociaux et leurs besoins énergétiques. De l’autre, ils font face à une méfiance persistante des investisseurs, alimentée par des dettes publiques jugées trop lourdes et une dépendance encore excessive aux matières premières.
Le poids insoutenable de la dette
La dette publique africaine a connu une progression spectaculaire au cours des vingt dernières années. Dans les années 2000, grâce aux initiatives internationales d’allègement comme l’Initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), de nombreux pays avaient retrouvé une marge de manœuvre budgétaire. Mais la décennie 2010 a marqué un tournant, avec une explosion des besoins de financement et une multiplication des emprunts sur les marchés internationaux.
Aujourd’hui, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne dépasse 60 % du PIB, un niveau proche de celui observé dans certaines économies émergentes d’Asie et d’Amérique latine. Mais contrairement à ces dernières, les pays africains supportent des taux d’intérêt beaucoup plus élevés. Le Ghana, par exemple, a connu une crise de liquidité en 2022 qui a conduit à un défaut de paiement partiel et à une restructuration de sa dette. Le Nigeria, première économie du continent, dépense désormais plus de 80 % de ses recettes fiscales au service de sa dette.
Moody’s insiste sur le caractère « insoutenable » de cette spirale : plus les pays empruntent cher, plus ils doivent consacrer une part importante de leur budget aux remboursements, ce qui les prive de moyens pour investir dans la santé, l’éducation ou les infrastructures.
Les marchés internationaux, entre prudence et méfiance
Sur les marchés financiers, les obligations africaines sont perçues comme des actifs à haut risque. Les investisseurs exigent donc des primes élevées pour compenser l’incertitude. Le contexte mondial aggrave cette situation : la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe depuis 2022 a renchéri le coût du capital partout dans le monde, rendant les dettes africaines encore moins attractives.
Moody’s souligne que même les économies considérées comme relativement stables, comme le Kenya ou l’Afrique du Sud, n’échappent pas à cette défiance. Le Kenya, pourtant cité comme l’un des pôles de dynamisme technologique du continent, doit emprunter à des taux supérieurs à 10 % pour financer ses projets. L’Afrique du Sud, qui dispose d’un marché financier plus mature, voit son coût d’emprunt grevé par la faiblesse de sa croissance et les difficultés chroniques de son secteur énergétique.
Le dilemme des gouvernements africains
Pour les dirigeants, le dilemme est cruel. Ils doivent financer des besoins immenses, notamment dans les infrastructures de transport, l’accès à l’énergie et la transition climatique. Selon la Banque africaine de développement, le continent a besoin de 68 à 108 milliards de dollars d’investissements annuels pour combler son déficit infrastructurel. Or, sans accès à des financements abordables, ces ambitions restent hors de portée.
Certains pays tentent de diversifier leurs sources. Le Sénégal, par exemple, a réussi récemment une émission obligataire domestique largement sursouscrite, témoignant de l’intérêt des investisseurs locaux. Mais cette stratégie a ses limites : les marchés domestiques restent étroits et ne permettent pas de mobiliser des sommes comparables à celles des marchés internationaux.
Les alternatives : FMI, Chine et finance innovante
Face à ces contraintes, plusieurs options s’offrent aux pays africains, aucune sans inconvénient. Le recours au Fonds monétaire international permet de bénéficier de prêts à taux relativement bas, mais au prix de réformes structurelles impopulaires. La Chine demeure un bailleur important, mais ses financements sont de plus en plus sélectifs et souvent conditionnés à des projets stratégiques qui servent ses propres intérêts géopolitiques.
Les institutions africaines plaident pour le développement d’instruments financiers alternatifs. Les obligations vertes et sociales, par exemple, pourraient permettre d’attirer des investisseurs soucieux d’impact. L’intégration régionale, via la Zone de libre-échange continentale africaine, est également perçue comme une solution pour stimuler la croissance et rassurer les marchés. Mais ces pistes nécessitent du temps, alors que les besoins sont urgents.
Le spectre d’une nouvelle crise de la dette
Moody’s avertit que, sans mesures correctives, plusieurs pays africains pourraient revivre une crise de la dette comparable à celle des années 1980. Le Ghana et la Zambie ont déjà connu des défauts de paiement récents, mais d’autres pays sont exposés à des risques similaires. L’Angola, malgré une amélioration de ses recettes pétrolières, reste dépendant des fluctuations des cours mondiaux. Le Kenya est sous pression en raison du poids de ses grands projets d’infrastructures financés par la dette. Quant au Nigeria, sa dépendance au pétrole rend son équilibre budgétaire extrêmement vulnérable.
Cette menace pèse aussi sur la crédibilité des réformes économiques. Si les pays africains doivent consacrer l’essentiel de leurs ressources à rembourser leurs créanciers, il devient difficile de convaincre leurs citoyens que les sacrifices consentis déboucheront sur un développement durable.
Une souveraineté économique en question
Au-delà des chiffres, la question posée par Moody’s est celle de la souveraineté économique. Tant que les pays africains dépendront des marchés internationaux pour financer leurs budgets, ils resteront vulnérables aux fluctuations mondiales et aux humeurs des agences de notation. Or, ces dernières ont souvent été critiquées pour leur vision occidentalo-centrée et leur tendance à accentuer les crises en dégradant les notes au moment le plus critique.
Certains économistes africains appellent donc à repenser le système dans son ensemble. Ils plaident pour une mobilisation accrue de l’épargne locale, une fiscalité plus efficace et une meilleure lutte contre l’évasion fiscale. Mais ces réformes se heurtent à des résistances politiques et à des contraintes sociales.
Conclusion : entre alerte et opportunité
L’avertissement de Moody’s n’est pas qu’une mauvaise nouvelle. Il rappelle aux gouvernements africains l’urgence de réformes structurelles et la nécessité de trouver des solutions endogènes. Le continent dispose de ressources immenses, tant naturelles qu’humaines, mais elles ne se traduiront en prospérité que si les États parviennent à maîtriser le piège de la dette.
L’histoire récente montre que l’Afrique a déjà su surmonter des crises financières majeures. La différence, aujourd’hui, est que le contexte mondial laisse moins de marges de manœuvre. Dans un environnement marqué par la concurrence géopolitique, la transition énergétique et la montée des populismes, les choix financiers des prochaines années détermineront en grande partie le visage économique du continent à l’horizon 2030.