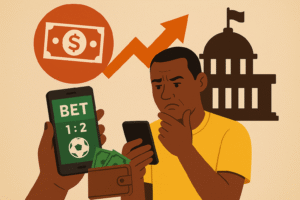Introduction : un deal stratégique en préparation
L’Angola, deuxième producteur de diamants en Afrique après le Botswana, se prépare à un mouvement stratégique qui pourrait redessiner la géopolitique mondiale du diamant : prendre une participation minoritaire dans De Beers, le géant sud-africain fondé en 1888 et désormais détenu par le groupe minier anglo-américain Anglo American. L’initiative, selon des sources proches du dossier, ne se limite pas à un simple investissement financier : elle s’inscrit dans une volonté panafricaine, associant également le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud, de peser davantage dans la gouvernance d’un marché qui génère des milliards de dollars mais profite encore trop peu aux populations africaines.
De Beers : l’empire historique des diamants
Difficile d’évoquer les diamants sans parler de De Beers. Fondée à la fin du XIXᵉ siècle par l’homme d’affaires Cecil Rhodes, l’entreprise a longtemps détenu un quasi-monopole sur le commerce mondial du diamant, contrôlant jusqu’à 80 % du marché dans les années 1980.
Aujourd’hui, De Beers reste un acteur clé, même si sa domination a été réduite à environ 30 % du marché mondial. Elle gère des mines en Afrique australe, au Canada et en Australie, et contrôle également la chaîne de valeur à travers la taille, la commercialisation et la certification des pierres.
Mais De Beers n’est pas seulement un empire économique : c’est aussi un symbole politique, incarnant à la fois la puissance coloniale et la dépendance des économies africaines vis-à-vis d’intérêts étrangers.
L’Angola : un producteur en quête de montée en gamme
Longtemps marqué par la guerre civile (1975-2002), l’Angola a reconstruit son secteur minier au fil des deux dernières décennies. Le pays est aujourd’hui le 6ᵉ producteur mondial de diamants et ambitionne de doubler sa production d’ici 2030.
- Production actuelle : environ 9 millions de carats par an.
- Objectif 2030 : dépasser les 20 millions de carats.
- Exportations : les diamants représentent plus de 10 % des recettes d’exportation du pays, derrière le pétrole.
Sous la présidence de João Lourenço, Luanda a entrepris de réformer le secteur : ouverture aux investisseurs étrangers, assainissement des circuits de vente, lutte contre la contrebande.
L’acquisition d’une part dans De Beers serait pour l’Angola une étape décisive pour accéder non seulement aux revenus de l’extraction, mais aussi à la gouvernance mondiale du secteur.
Un projet panafricain : Botswana, Namibie, Afrique du Sud en soutien
Selon des sources régionales, l’Angola ne serait pas seul dans cette démarche. Le projet envisagé impliquerait aussi le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud, trois pays déjà très liés à De Beers.
- Le Botswana : copropriétaire de Debswana (coentreprise avec De Beers) et premier producteur mondial en valeur.
- La Namibie : partenaire via Namdeb, exploitant les diamants marins au large de l’Atlantique.
- L’Afrique du Sud : berceau historique de De Beers, où l’entreprise garde des activités stratégiques.
Un tel regroupement formerait un bloc africain inédit dans l’industrie diamantaire, renforçant la capacité des pays producteurs à négocier face aux grandes multinationales et aux marchés internationaux (Anvers, Dubaï, Mumbai).
Les motivations angolaises
Pourquoi l’Angola veut-il entrer dans le capital de De Beers ? Plusieurs raisons expliquent cette stratégie :
- Diversification des revenus : Luanda cherche à réduire sa dépendance au pétrole, qui représente encore plus de 90 % de ses exportations.
- Accès à la chaîne de valeur : en devenant actionnaire, l’Angola espère peser sur les choix en matière de taille, de certification et de commercialisation.
- Renforcement de son image : l’Angola veut s’imposer comme un acteur central de l’industrie diamantaire mondiale, aux côtés du Botswana.
- Partenariat sud-sud : l’idée d’une coalition régionale s’inscrit dans un agenda panafricaniste, cherchant à transformer les ressources naturelles en levier d’intégration économique.
Les enjeux géopolitiques
L’entrée de l’Angola dans De Beers aurait des répercussions au-delà du secteur minier :
- Relations Afrique – Occident : Anglo American, maison mère de De Beers, pourrait voir son contrôle remis en question. Une montée en puissance africaine pourrait rééquilibrer la gouvernance.
- Concurrence avec la Russie : le géant russe Alrosa, premier producteur mondial en volume, est fragilisé par les sanctions occidentales depuis la guerre en Ukraine. L’Afrique pourrait combler une partie de ce vide.
- Influence de la Chine : Pékin, grand consommateur de diamants et investisseur majeur en Afrique, observe de près ces évolutions. Une gouvernance africaine renforcée pourrait compliquer son accès direct aux ressources.
Les défis à surmonter
Malgré son ambition, le projet angolais devra relever plusieurs obstacles :
- Financement : la prise de participation nécessitera des milliards de dollars. Or, l’Angola fait face à une dette publique élevée.
- Transparence : le secteur diamantaire angolais est encore critiqué pour son manque de clarté. Des scandales passés liés à la Sonangol ou à la gestion des diamants de la Lunda Norte continuent de nourrir la méfiance.
- Consensus régional : bâtir une alliance avec le Botswana, la Namibie et l’Afrique du Sud demandera une fine diplomatie.
- Risque de dépendance : en s’associant à De Beers, l’Angola devra trouver un équilibre entre souveraineté et partenariat.
Vers un nouveau modèle africain ?
Au-delà des chiffres, l’initiative angolaise pose une question plus large : l’Afrique peut-elle enfin passer du statut de fournisseur de matières premières à celui de co-gouvernant de filières mondiales ?
Le succès de cette démarche dépendra de la capacité des pays africains à :
- investir dans la transformation locale (taille, joaillerie),
- réguler efficacement le secteur pour éviter la contrebande,
- construire une marque « diamant africain » valorisant l’origine éthique et responsable des pierres.
Conclusion : une bataille pour la souveraineté
Si l’Angola réussit à acquérir une part dans De Beers, ce sera un tournant historique : pour la première fois, des pays producteurs africains siégeraient directement dans l’actionnariat du plus grand négociant de diamants au monde.
Ce mouvement traduirait une volonté de souveraineté économique, mais aussi de réécriture de l’histoire. Pendant plus d’un siècle, l’Afrique a été le théâtre d’une exploitation qui enrichissait d’autres continents. Aujourd’hui, elle aspire à devenir l’architecte de son propre destin dans l’un des marchés les plus symboliques du capitalisme mondial.
Le diamant, jadis surnommé « la malédiction africaine », pourrait alors devenir un levier d’unité et de puissance collective.