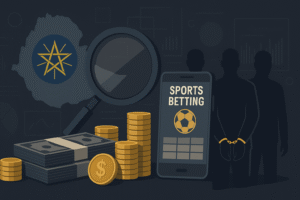En septembre 2025, Interpol a frappé fort. L’organisation internationale de police a annoncé l’arrestation de plus de 260 individus dans quatorze pays africains, à la suite d’une vaste opération coordonnée contre les réseaux de cybercriminalité. Cette offensive, menée à l’échelle du continent, visait des escroqueries en ligne devenues tristement familières : les arnaques sentimentales, aussi appelées « romance scams », où des victimes se laissent piéger par de fausses histoires d’amour pour finalement envoyer leur argent, et les opérations de sextorsion, qui consistent à piéger des internautes à travers des contenus intimes pour les faire chanter. L’envergure de cette opération baptisée HAECHI IV montre bien que le phénomène a atteint une ampleur qui dépasse les frontières nationales et appelle une réponse internationale.
La montée de la cybercriminalité en Afrique est directement liée à la croissance fulgurante du numérique sur le continent. L’Afrique compte désormais plus d’un demi-milliard d’utilisateurs réguliers d’Internet, et les services de paiement mobile représentent un volume d’échanges supérieur à 700 milliards de dollars par an. Cet essor ouvre des perspectives inédites pour l’inclusion financière, le commerce électronique et l’innovation, mais il attire aussi ceux qui cherchent à exploiter les failles techniques et humaines. Pour de nombreux jeunes confrontés au chômage massif et au manque de perspectives, les arnaques en ligne apparaissent comme une échappatoire. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire ou le Cameroun sont régulièrement cités dans les rapports d’Interpol comme des foyers actifs de ce type de criminalité, où les « Yahoo Boys » se forgent même une réputation paradoxale de réussite sociale.
L’opération menée par Interpol a mobilisé les forces de police de plusieurs États africains, du Kenya à l’Afrique du Sud, en passant par le Sénégal, le Ghana ou la Côte d’Ivoire. Les autorités ont saisi des centaines de téléphones, d’ordinateurs et de serveurs, bloqué des comptes bancaires et interrompu des transferts de fonds illicites. Si les chiffres avancés — 260 arrestations, plusieurs millions de dollars interceptés — donnent une idée de l’ampleur du réseau démantelé, ils ne sont sans doute qu’une fraction d’un iceberg beaucoup plus large. Selon les estimations, les pertes liées à la cybercriminalité en Afrique subsaharienne dépasseraient 3,5 milliards de dollars par an. Mais la réalité est probablement plus élevée, tant le nombre de victimes qui n’osent pas porter plainte reste important, par honte ou par crainte de représailles.
Derrière les statistiques se cachent des trajectoires humaines complexes. À Lagos, certains jeunes arrêtés racontent qu’ils sont entrés dans ce milieu faute d’alternative. Un ancien cybercriminel se souvient avoir gagné en quelques mois ce que ses parents n’auraient pas accumulé en toute une vie de travail. La tentation est immense pour une jeunesse souvent diplômée mais sans emploi stable. De l’autre côté du monde, des retraités européens ou nord-américains témoignent de l’autre facette du drame : l’humiliation d’avoir été dupés, la perte de leurs économies, parfois un isolement social accru après avoir été ridiculisés pour leur naïveté. Ces récits montrent que la cybercriminalité africaine n’est pas un problème localisé, mais bien un phénomène transcontinental.
Les institutions tentent de répondre à ce défi. Interpol a multiplié les opérations coordonnées et encourage les pays africains à créer des cyber-unités spécialisées. L’Union africaine a adopté en 2014 la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données, un cadre juridique censé harmoniser les approches nationales. Mais cette convention reste inégalement ratifiée et appliquée, faute de moyens et parfois de volonté politique. Les banques et les entreprises de mobile money, conscientes que la confiance des usagers est leur capital le plus précieux, investissent dans des solutions de sécurité sophistiquées, allant de l’authentification biométrique à la surveillance en temps réel des transactions. Pourtant, malgré ces efforts, les failles demeurent nombreuses et les régulateurs peinent à suivre la cadence d’une criminalité toujours plus inventive.
La répression spectaculaire menée par Interpol soulève cependant plusieurs interrogations. Les arrestations massives sont efficaces pour envoyer un signal, mais elles ne garantissent pas que les personnes arrêtées seront condamnées. Les systèmes judiciaires africains manquent souvent d’outils pour gérer la preuve numérique, et de nombreux dossiers s’effondrent faute d’éléments recevables devant les tribunaux. Par ailleurs, certains observateurs s’inquiètent de la stigmatisation d’une jeunesse africaine déjà fragilisée, craignant que la lutte contre les cyber-escroqueries ne devienne un prétexte à des arrestations arbitraires visant des jeunes simplement parce qu’ils utilisent des technologies avancées ou affichent un train de vie suspect.
Au-delà des questions de justice, c’est un enjeu de souveraineté numérique qui se joue. Tant que les infrastructures, les plateformes et les données restent sous contrôle d’acteurs étrangers, les pays africains auront du mal à sécuriser efficacement leur cyberespace. Aujourd’hui, la plupart des données africaines circulent via des serveurs basés en Europe ou aux États-Unis. Les grandes plateformes qui servent de terrain aux escroqueries — Facebook, Instagram, WhatsApp, Tinder — appartiennent à des entreprises étrangères, qui définissent leurs propres règles de modération et coopèrent plus ou moins efficacement avec les autorités locales. Cette dépendance structurelle affaiblit la capacité des États africains à lutter durablement contre la cybercriminalité.
Pour les experts, la solution ne peut pas être uniquement policière. La prévention doit passer par l’éducation numérique des populations, afin que les internautes soient capables d’identifier les signaux d’alerte d’une arnaque. Mais surtout, la lutte contre la cybercriminalité est indissociable de la création d’emplois légitimes pour les jeunes. Tant que le chômage massif persistera, les escroqueries en ligne resteront une tentation pour des milliers de diplômés sans perspective. C’est donc tout un modèle économique et social qui est en jeu.
L’opération HAECHI IV marque un tournant. Elle démontre que la coopération internationale peut produire des résultats tangibles et que l’Afrique n’est pas condamnée à rester un terrain de jeu pour les cybercriminels. Mais elle rappelle aussi que la répression seule ne suffira pas. Le combat doit être mené sur plusieurs fronts : juridique, éducatif, économique et technologique. À défaut, les arrestations spectaculaires risquent de n’être que des coups d’épée dans l’eau, pendant que de nouveaux réseaux, plus sophistiqués encore, prendront la relève.
L’Afrique est aujourd’hui à la croisée des chemins. Le continent possède à la fois l’une des jeunesses les plus dynamiques du monde et l’un des cyberespaces les plus vulnérables. Selon la voie qu’il choisira, la révolution numérique pourra être soit un levier d’émancipation, soit une source accrue d’insécurité. La bataille contre la cybercriminalité, symbolisée par l’action d’Interpol, n’est en réalité qu’une partie d’un combat plus vaste pour l’autonomie, la confiance et la souveraineté numérique du continent.