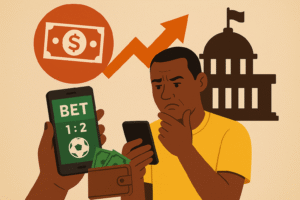À Dakar, la présentation du nouveau plan de redressement économique et social 2025-2028 a été saluée par le gouvernement comme une étape décisive pour sortir le pays de la spirale d’endettement et remettre de l’ordre dans les finances publiques. Mais derrière l’annonce officielle, un climat de scepticisme et de crispation domine, tant les arbitrages proposés paraissent douloureux et potentiellement explosifs sur le plan social.
Le contexte est lourd. La dette publique sénégalaise atteint des niveaux jugés préoccupants par les bailleurs internationaux. Les emprunts contractés ces dernières années pour financer les grands projets d’infrastructures pèsent désormais lourdement sur le budget national. Le pays, comme de nombreux voisins de la zone UEMOA, est confronté à la double contrainte d’un service de la dette écrasant et d’un coût de financement en hausse, les taux exigés par les marchés atteignant parfois des niveaux insoutenables. C’est dans ce cadre tendu que le plan 2025-2028 a été élaboré, sous la pression des créanciers et des institutions financières internationales.
Le document met en avant une stratégie de « rationalisation budgétaire » et de « relance inclusive », deux expressions qui masquent en réalité des mesures de rigueur. La plus controversée est sans doute l’introduction d’une nouvelle fiscalité sur les transactions électroniques, en particulier le mobile money. À l’heure où ce mode de paiement est devenu le principal outil financier de millions de Sénégalais, taxer ces opérations revient à frapper directement les classes populaires et la jeunesse urbaine. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité d’élargir l’assiette fiscale et de mobiliser des ressources internes, mais le risque politique est immense : la population pourrait percevoir cette taxe comme une punition infligée à ceux qui ont trouvé dans le mobile money un substitut à un système bancaire jugé élitiste et inaccessible.
Derrière cette taxe, c’est toute la logique du plan qui soulève des interrogations. Le gouvernement promet des investissements ciblés dans l’éducation, la santé et les infrastructures sociales, mais ces promesses reposent sur des hypothèses de recettes fiscales supplémentaires et sur une maîtrise rigoureuse des dépenses publiques. Les marges de manœuvre apparaissent faibles, et le spectre d’une austérité déguisée plane sur le pays. Les coupes prévues dans certaines subventions et la révision des dépenses jugées non prioritaires pourraient se traduire par une hausse du coût de la vie, alors même que le pouvoir d’achat des ménages est déjà fragilisé par l’inflation et la dépréciation du franc CFA.
Un autre aspect sensible du plan concerne les grands projets d’infrastructures. Certains chantiers lancés sous l’ancien régime, notamment dans les transports et l’énergie, sont désormais remis en cause ou ralentis. Les autorités affirment vouloir privilégier les projets à « fort impact social », mais derrière ce discours se cache la réalité d’un État contraint de faire des choix douloureux, faute de moyens financiers. L’arrêt ou le report de certains projets phares pourrait alimenter des tensions politiques, surtout dans un pays où les infrastructures sont souvent perçues comme des symboles visibles du développement et de l’action gouvernementale.
Le plan insiste également sur la nécessité de renforcer la lutte contre la corruption et d’améliorer la transparence budgétaire. Mais la crédibilité de cet engagement reste fragile, tant les scandales financiers passés ont nourri la méfiance de l’opinion publique. La défiance s’accroît lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact réel des réformes annoncées : le Sénégal a déjà connu plusieurs plans de redressement dans le passé, souvent applaudis par les bailleurs mais dont les résultats sur la vie quotidienne des citoyens sont restés limités.
Un autre élément à souligner est l’influence des institutions internationales dans l’élaboration de ce programme. Si le gouvernement sénégalais insiste sur le caractère souverain de ses choix, de nombreux analystes estiment que les recommandations du FMI et de la Banque mondiale ont largement orienté le contenu du plan. Le Sénégal, fortement dépendant de l’aide extérieure et des financements multilatéraux, dispose de marges réduites pour négocier. Cette dépendance alimente un débat sur la souveraineté économique du pays et sur le risque de voir ses politiques publiques dictées davantage par ses créanciers que par ses besoins internes.
Le volet social du plan est présenté comme un contrepoids destiné à apaiser les critiques. Il inclut des engagements sur la création d’emplois, le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et la mise en place de programmes sociaux ciblés. Mais là encore, la question des moyens reste entière. Le chômage des jeunes, qui touche une part importante de la population active, demeure un problème structurel. Les promesses de financement pour soutenir les petites et moyennes entreprises risquent de rester lettre morte si les ressources fiscales attendues ne se matérialisent pas ou si la pression de la dette absorbe l’essentiel du budget.
Au-delà des chiffres, l’enjeu est politique. Le gouvernement joue sa crédibilité sur la capacité de ce plan à redresser les comptes sans provoquer de mouvements sociaux majeurs. Les dernières années ont été marquées par une montée des contestations, en particulier chez les jeunes qui se mobilisent contre le chômage, la vie chère et la corruption. La taxation du mobile money pourrait devenir l’étincelle d’une colère plus large, perçue comme l’incarnation d’un pouvoir déconnecté des réalités quotidiennes.
Le plan de redressement économique et social du Sénégal 2025-2028 illustre ainsi les dilemmes auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Pris en étau entre une dette écrasante, des créanciers exigeants et une population qui réclame des améliorations rapides de ses conditions de vie, les gouvernements doivent arbitrer entre rigueur et relance, entre dépendance et souveraineté. Dans ce jeu d’équilibriste, le risque est grand de voir les promesses officielles se heurter à la dure réalité des contraintes financières.