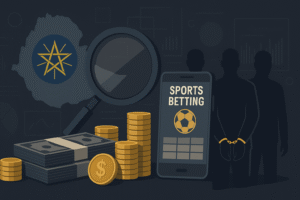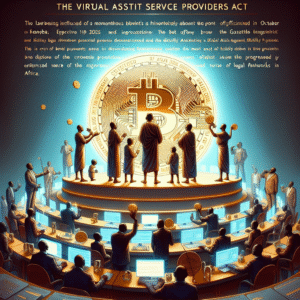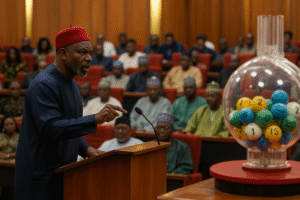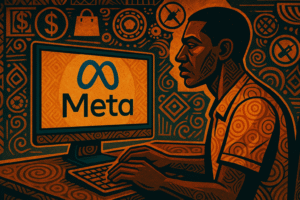Le Nigeria vient d’annoncer une série de nouvelles mesures pour renforcer le contrôle de l’État sur l’industrie des cryptomonnaies. Licences obligatoires, obligations fiscales élargies, surveillance accrue des plateformes : le pays, longtemps considéré comme un pionnier africain des actifs numériques, choisit désormais la fermeté. Un tournant qui divise — entre ceux qui y voient un pas vers la stabilité, et ceux qui redoutent un coup d’arrêt à l’innovation.
Un nouveau cadre légal pour un marché devenu géant
Avec plus de 22 millions d’utilisateurs estimés et près de 92 milliards de dollars de transactions annuelles, le Nigeria figure parmi les marchés crypto les plus actifs au monde.
Mais pour les autorités, cet engouement s’est accompagné de risques massifs : blanchiment, escroqueries, évasion de capitaux et spéculation incontrôlée sur le naira.
Après plusieurs années d’hésitation — entre interdiction, tolérance et flou juridique — Abuja a décidé de reprendre la main.
La Banque centrale du Nigeria (CBN) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont conjointement publié de nouvelles directives imposant aux plateformes crypto un régime d’autorisation stricte.
Les prestataires devront désormais obtenir une licence officielle, justifier d’un dispositif de lutte contre le blanchiment (KYC/AML), et transmettre régulièrement leurs données d’activité aux autorités.
Les sanctions prévues sont dissuasives : amende de ₦10 millions dès le premier mois de non-conformité, puis ₦1 million par mois de retard, assortie d’un risque de suspension ou de retrait de licence.
Les banques, qui avaient interdiction depuis 2021 de servir les entreprises crypto, sont désormais autorisées à le faire… à condition de respecter un protocole de surveillance renforcé.
L’argument du gouvernement : stabilité et souveraineté
Pour le gouvernement Tinubu, ces mesures sont d’abord une question de sécurité économique et monétaire.
« Le Nigeria ne peut plus tolérer un marché financier parallèle qui échappe totalement au contrôle de l’État », confie un conseiller du ministère des Finances.
La dépréciation historique du naira — plus de 70 % en un an — a en effet poussé des millions de Nigérians à se réfugier dans les cryptomonnaies, perçues comme une valeur refuge face à l’inflation galopante.
Résultat : une « cryptodollarisation » progressive de l’économie, que les autorités veulent désormais freiner.
Les stablecoins (notamment l’USDT) sont devenus un substitut officieux au dollar, facilitant les transferts transfrontaliers… mais aussi la fuite de devises hors du pays.
Selon le gouverneur de la CBN, 26 milliards de dollars auraient transité via Binance en un an depuis des sources jugées “intraçables”.
Le durcissement vise aussi à étendre la base fiscale.
Pour la première fois, les plus-values sur crypto-actifs sont imposables.
La Nigeria Tax Administration Act 2025 oblige les plateformes à déclarer leurs revenus et leurs utilisateurs, avec pour ambition d’accroître les recettes publiques d’un pays où les recettes fiscales ne dépassent pas 10 % du PIB.
L’affaire Binance, symbole d’un changement d’époque
Le bras de fer avec Binance, la plus grande bourse mondiale de cryptomonnaies, a marqué un tournant.
En février 2024, deux dirigeants de la plateforme avaient été arrêtés à Lagos pour « évasion fiscale et manipulation du marché ».
L’affaire a fait le tour du monde, signalant la volonté du Nigeria d’imposer son autorité sur un secteur longtemps laissé à lui-même.
Depuis, d’autres plateformes internationales, comme OKX ou KuCoin, ont réduit leur présence dans le pays.
Certaines, confrontées à la lourdeur administrative et à la menace de poursuites, préfèrent se retirer.
Une fuite qui inquiète une partie des acteurs locaux : « On veut réguler, pas tuer le marché », confie un entrepreneur fintech de Lagos.
« Mais aujourd’hui, la plupart des petites start-up n’ont ni les moyens ni la visibilité pour se mettre en conformité. »
Les inquiétudes d’un écosystème en tension
Du côté des utilisateurs, le durcissement est perçu comme une épée à double tranchant.
Certes, la régulation pourrait renforcer la sécurité et la confiance dans un marché jusque-là miné par les escroqueries.
Mais elle risque aussi de renchérir les coûts et de réduire l’accès à certaines plateformes internationales.
« Nous sommes passés d’un Far West numérique à une forteresse administrative », résume un trader indépendant d’Abuja.
« Les frais augmentent, les vérifications se multiplient, et les transferts deviennent plus lents. »
Beaucoup craignent un retour massif vers le marché informel, notamment les échanges de pair à pair (P2P), difficiles à contrôler.
La diaspora nigériane, qui envoie chaque année plus de 20 milliards de dollars au pays, s’inquiète également.
Les cryptomonnaies et les stablecoins facilitaient jusqu’ici les transferts rapides et à faible coût.
La nouvelle législation risque de ralentir ces flux, voire d’en détourner une partie vers des canaux non déclarés.
Entre innovation et contrôle : un équilibre fragile
Le Nigeria n’est pas seul dans ce mouvement.
De l’Inde à l’Union européenne, la régulation des cryptos s’accélère partout.
Mais dans un pays où un tiers de la population détient déjà des actifs numériques, l’enjeu dépasse la simple conformité.
Il s’agit de trouver un équilibre entre souveraineté monétaire, stabilité financière et dynamisme technologique.
Certains experts plaident pour une approche plus « progressive », fondée sur le dialogue.
« Le Nigeria peut réguler sans étouffer », explique un analyste de Financial Afrik.
« Il doit éviter de criminaliser l’innovation. La solution n’est pas la répression, mais la co-construction d’un cadre de confiance. »
Une bataille d’influence et d’image
Derrière les chiffres, se joue aussi une bataille de réputation.
Le pays, premier hub fintech d’Afrique, cherche à rassurer ses partenaires internationaux après plusieurs années de volatilité réglementaire.
Mais en voulant apparaître exemplaire, Abuja prend le risque de fragiliser un écosystème qui a fait sa force.
Les prochains mois seront décisifs :
si la réforme parvient à structurer sans brider, le Nigeria pourrait devenir un modèle de régulation crypto pour l’Afrique.
Mais si elle se transforme en carcan bureaucratique, elle pourrait accélérer la fuite des talents et des capitaux vers d’autres places plus accueillantes comme Dubaï, Nairobi ou Johannesburg.
Le pari nigérian
En toile de fond, une question essentielle demeure :
le Nigeria veut-il dompter la crypto ou la comprendre ?
Le pays mise sur une “régulation par excès de prudence”, espérant canaliser la puissance d’un marché qu’il ne peut plus ignorer.
Mais dans une économie jeune, numérique et mondialisée, la maîtrise ne se décrète pas : elle se construit.
Et dans ce domaine, le Nigeria vient peut-être de lancer la plus grande expérience africaine de régulation à ciel ouvert.