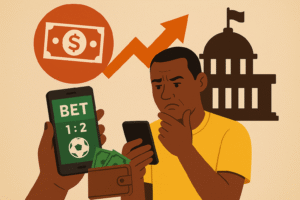Un accord qui a changé la donne
Depuis son adoption en mai 2000, l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), souvent présenté comme le « pacte phare » des relations économiques entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne, a permis à plus de 35 pays africains d’accéder au marché américain avec des avantages commerciaux uniques. En offrant un accès sans droits de douane à plus de 6 500 produits, cet accord a représenté pour beaucoup une bouée de sauvetage, mais aussi un catalyseur pour la diversification économique.
Vingt-cinq ans plus tard, le débat sur son renouvellement occupe de nouveau le devant de la scène. L’administration américaine, par la voix de certains conseillers proches du président, a récemment exprimé son soutien à une prolongation de l’accord, alors que celui-ci arrive à échéance en 2025. Un sujet qui cristallise à la fois espoirs et inquiétudes sur le continent africain.
AGOA en chiffres : un bilan contrasté
En deux décennies, l’AGOA a contribué à faire progresser les exportations africaines vers les États-Unis. En 2023, la valeur totale des échanges sous l’accord s’élevait à environ 30 milliards de dollars, contre 8 milliards à son lancement.
- L’énergie domine toujours : près de 60 % des exportations restent concentrées sur le pétrole et le gaz (notamment du Nigeria et de l’Angola).
- L’industrie textile : certains pays comme l’Éthiopie, le Lesotho ou Madagascar ont su profiter de l’AGOA pour développer un secteur textile orienté vers l’exportation.
- L’agriculture : les exportations de produits agricoles (mangues, avocats, noix de cajou) ont progressé, mais demeurent limitées par des normes sanitaires strictes.
Pourtant, malgré ces résultats, de nombreux observateurs estiment que le potentiel de l’AGOA n’a pas été pleinement exploité. En cause : la faiblesse des infrastructures africaines, les barrières logistiques et le manque de valeur ajoutée locale.
Les espoirs autour du renouvellement
Pour de nombreux gouvernements africains, une prolongation de l’AGOA est vitale. L’accord est perçu comme une assurance contre l’isolement commercial, surtout dans un contexte où les négociations multilatérales à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peinent à progresser.
« Sans l’AGOA, nos exportations textiles risquent de s’effondrer », avertissait récemment un représentant du gouvernement kényan. Le Kenya, qui compte plus de 50 000 emplois liés directement aux usines textiles exportant vers les États-Unis, illustre bien cette dépendance.
L’Afrique du Sud, elle, plaide pour une extension « modernisée », incluant des produits comme les voitures électriques ou les batteries au lithium, afin de refléter les nouvelles réalités industrielles du continent.
Les critiques américaines : dépendance ou opportunité ?
Aux États-Unis, l’AGOA fait aussi débat. Certains parlementaires républicains estiment que l’accord favorise « des économies peu démocratiques » et devrait être conditionné à des critères plus stricts en matière de gouvernance et de droits humains.
D’autres, au contraire, voient dans l’AGOA un instrument stratégique pour contrer l’influence croissante de la Chine en Afrique. Pékin, à travers son initiative des « Nouvelles routes de la soie », multiplie en effet les investissements massifs en infrastructures et en prêts. Pour Washington, renforcer les liens commerciaux par l’AGOA peut être un moyen de rééquilibrer le rapport de force.
Le défi de l’industrialisation africaine
L’un des reproches majeurs adressés à l’AGOA est de ne pas avoir véritablement contribué à l’industrialisation de l’Afrique. Si certains pays ont vu émerger des secteurs dynamiques (textile, horticulture), la majorité reste cantonnée à l’exportation de matières premières.
Or, la nouvelle génération de dirigeants africains insiste sur la nécessité de transformer localement les ressources. « Nous ne voulons plus exporter du cacao brut, mais du chocolat », affirmait récemment le président ivoirien Alassane Ouattara.
Le renouvellement de l’AGOA pourrait donc être l’occasion d’introduire des clauses favorisant davantage la valeur ajoutée locale et la montée en gamme des industries africaines.
Les pays exclus : une fracture politique
L’AGOA n’inclut pas tous les pays africains. Certains ont été exclus en raison de violations des droits humains ou de coups d’État (Zimbabwe, Mali, Guinée, Soudan). Cette exclusion crée un deux poids deux mesures que dénoncent certains analystes.
En Éthiopie, par exemple, l’exclusion du pays en 2022 à cause du conflit au Tigré a eu des effets dévastateurs sur l’emploi, notamment dans les usines textiles. Des dizaines de milliers de travailleurs, pour la plupart des jeunes femmes, ont perdu leur revenu.
Cela pose une question cruciale : l’AGOA doit-il être un instrument purement commercial, ou aussi un levier politique et diplomatique pour pousser les régimes africains vers plus de démocratie ?
AGOA et ZLECAf : complémentarité ou concurrence ?
L’Afrique avance aussi sur un autre chantier historique : la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en 2021. Son objectif est de créer un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs.
Certains experts craignent que l’AGOA détourne l’attention des pays africains de la ZLECAf, en les incitant à privilégier l’accès au marché américain plutôt qu’à renforcer les échanges intra-africains.
D’autres, au contraire, voient une complémentarité : l’AGOA peut être une rampe de lancement pour les industries africaines, avant qu’elles ne s’orientent vers un marché continental plus intégré.
Les négociations à venir
Si le soutien affiché par certains conseillers américains est un signal positif, le chemin vers une prolongation n’est pas garanti. L’accord doit être validé par le Congrès américain, où les débats s’annoncent animés.
Plusieurs pistes circulent déjà :
- Renouvellement simple : prolonger l’accord dans sa forme actuelle pour 10 ou 15 ans.
- Modernisation : intégrer des secteurs comme les énergies renouvelables, la tech et le numérique.
- Conditionnalité accrue : lier l’accès aux marchés américains à des engagements précis en matière de droits humains, de gouvernance et de climat.
Conclusion : un enjeu stratégique
Le renouvellement de l’AGOA dépasse la simple question commerciale. Il s’agit d’un enjeu géopolitique et économique majeur pour l’Afrique et pour les États-Unis.
Pour l’Afrique, l’accord représente une opportunité de consolider ses exportations, d’attirer des investissements et de soutenir l’emploi. Mais pour être véritablement utile, il doit encourager une industrialisation locale et éviter de renforcer la dépendance aux matières premières.
Pour les États-Unis, l’AGOA est une façon de maintenir un ancrage stratégique sur le continent face à la Chine, tout en renforçant une image de partenaire économique.
À l’heure où l’Afrique cherche à affirmer sa souveraineté économique, le sort de l’AGOA sera donc scruté de près. Car de cette décision dépend une partie du futur commercial du continent.